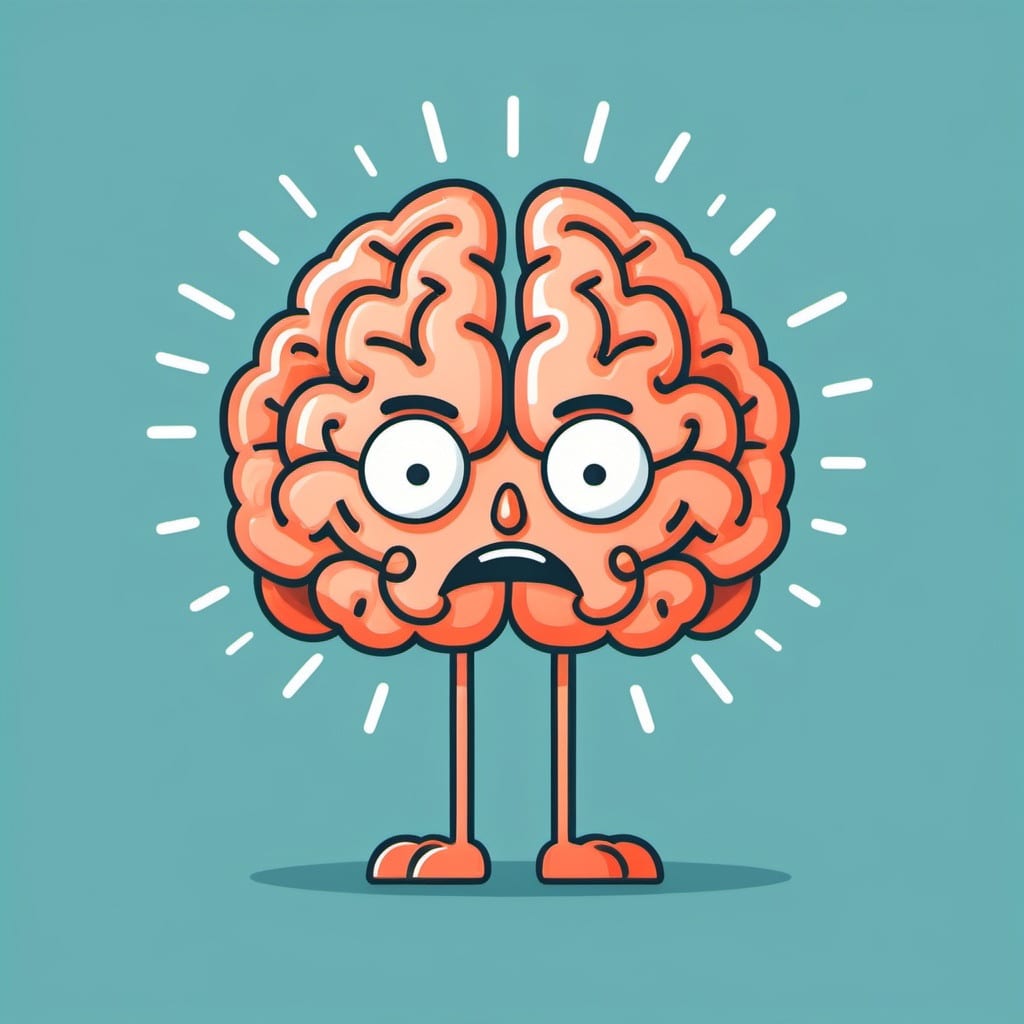Le cerveau, organe fascinant et complexe, est souvent entouré de mythes qui peuvent influencer notre perception de nous-mêmes et des autres. Démystifions quelques idées reçues sur le fonctionnement du cerveau.
| Sommaire : Mythe 1 : Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau Mythe 2 : Le cerveau des adultes ne peut pas changer Mythe 3 : Les jeunes cerveaux sont plus malins que les cerveaux âgés Mythe 4 : L’intelligence est uniquement déterminée par la génétique Mythe 5 : Les hommes et les femmes ont des cerveaux fondamentalement différents Mythe 6 : “Cerveau gauche” VS “Cerveau droit” |
Mythe 1 : Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau
Réalité : Toutes les parties du cerveau ont une fonction et sont actives à différents moments.
Les recherches en neurosciences montrent que l’ensemble du cerveau est actif, même lorsque nous sommes au repos. Les techniques d’imagerie cérébrale, comme l’IRM fonctionnelle, montrent que différentes zones du cerveau sont impliquées dans une multitude de tâches, qu’il s’agisse de résoudre un problème, de rêver ou encore de se remémorer un souvenir. L’idée que nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau est un mythe popularisé par la culture hollywoodienne (Lucy, Limitless). En réalité, les neurosciences montrent que l’ensemble du cerveau est actif, même au repos, et qu’il consomme environ 20 % de l’énergie corporelle.
Ce mythe pourrait venir du psychologue William James, à l’origine de la théorie de la « réserve d’énergie », ou du neurochirurgien Wilder Penfield, dont les recherches montraient que 10 % des stimulations cérébrales entraînaient une réponse visible, sans pour autant signifier que le reste était inactif. Une autre théorie sur l’émergence de ce mythe viendrait d’une confusion scientifique à la suite de la découverte de l’existence des cellules gliales qui remplissent les espaces laissés par les neurones et protègent les connexions nerveuses entre ces dernières. Lors de leur découverte, nous pensions qu’elles constituaient jusqu’à 90% du cerveau (alors qu’en réalité nous serions plus proche de 50%). Ne connaissant pas réellement leurs fonctions, certains émirent ainsi l’hypothèse que seul 10% de notre cerveau étaient exploités.
En réalité, le cerveau est en perpétuelle activité, qu’il traite des souvenirs, régule des émotions ou assure des fonctions vitales. Même chez les aveugles, les zones cérébrales dédiées à la vision se réorganisent pour d’autres fonctions, illustrant la plasticité du cerveau. Plutôt que de chercher à “débloquer” un potentiel caché, mieux vaut stimuler et entretenir nos capacités.
Mythe 2 : Le cerveau des adultes ne peut pas changer
Réalité : Le cerveau est capable de se remodeler et d’établir de nouvelles connexions tout au long de la vie.
Le cerveau est capable de se remodeler et d’établir de nouvelles connexions tout au long de la vie, un processus connu sous le nom de neuroplasticité. Cette capacité de modification est particulièrement marquée lors de l’apprentissage, mais aussi en réponse à des blessures. Des études ont démontré que des adultes peuvent non seulement apprendre de nouvelles compétences, mais aussi récupérer des fonctions perdues après un AVC, grâce à la plasticité cérébrale. Toutefois, cette capacité de transformation est modulée par divers facteurs, notamment l’âge, le type de blessure ou encore la région du cerveau affectée.
La neuroplasticité n’est pas un phénomène uniforme tout au long du développement du cerveau. En réalité, il existe des fenêtres critiques où certaines régions du cerveau sont plus ou moins réactives aux expériences. Par exemple, les recherches ont montré que si le cortex moteur est endommagé durant l’adolescence précoce, les résultats sont moins favorables que lorsqu’il est blessé en fin d’adolescence. Cependant, ce n’est pas le cas pour toutes les régions du cerveau : le cortex préfrontal, par exemple, présente une dynamique inverse. Cela suggère que chaque région cérébrale pourrait avoir des périodes sensibles, ou des fenêtres critiques, où elle est plus susceptible aux modifications dues à l’expérience. Cette plasticité, également appelée métaplasticité, implique que les expériences vécues au cours de la vie n’agissent pas comme des événements isolés, mais interagissent entre elles pour moduler à la fois le comportement et la structure du cerveau.
En outre, les changements plastiques au niveau des synapses, bien qu’importants, ne constituent qu’un aspect de la réorganisation cérébrale. Des recherches de plus en plus poussées suggèrent que ces modifications se produisent également au niveau de l’expression génétique, avec des centaines de gènes potentiellement impliqués dans la réponse du cerveau aux expériences et aux traumatismes.
Mythe 3 : Les jeunes cerveaux sont plus malins que les cerveaux âgés
Réalité : Les cerveaux plus âgés peuvent exceller dans des domaines comme la sagesse, l’expérience et la prise de décision.
Bien que la vitesse de traitement de l’information puisse diminuer avec l’âge, les personnes âgées sont capables de prendre des décisions fondées sur des connaissances antérieures accumulées durant leur vie. Cette expertise leur permet souvent d’aborder des problèmes complexes avec un discernement et une profondeur d’analyse supérieurs, compensant ainsi certaines des déclinaisons cognitives observées dans des domaines tels que la mémoire, le langage ou la fonction exécutive. Leur mémoire sémantique (la mémoire des faits) est supérieure à celle des personnes plus jeunes.
Les recherches en neurologie montrent des déclins dans le volume de la matière grise et blanche, ainsi que des changements dans les niveaux de neurotransmetteurs, mais ces facteurs ne masquent pas les avantages de la maturité cognitive. Ces changements permettent tout de même de conserver un bon niveau de fonctionnement et d’autonomie.
Mythe 4 : L’intelligence est uniquement déterminée par la génétique
Réalité : De nombreux facteurs environnementaux, culturels et éducatifs influencent le développement de l’intelligence.
Les études sur les jumeaux montrent que, bien que la génétique joue un rôle, l’environnement d’apprentissage, les interactions sociales et les expériences de vie sont également cruciaux dans le développement des capacités cognitives. A l’enfance, on considère que 20% de l’intelligence provient de facteurs héréditaires contre 80% à l’âge adulte. Ces résultats suggèrent que l’environnement est crucial pour le développement intellectuel pendant l’enfance, mais que, plus tard dans la vie, l’influence des gènes devient plus importante.
Mythe 5 : Les hommes et les femmes ont des cerveaux fondamentalement différents
Réalité : Bien qu’il existe des différences structurelles, les capacités cognitives sont souvent plus similaires qu’on ne le pense.
Les stéréotypes de genre souvent associés à des différences cérébrales peuvent nuire à la perception des capacités intellectuelles. Des études montrent que, même s’il existe des variations, les capacités cognitives des hommes et des femmes se chevauchent considérablement. De subtiles différences existent : par exemple dans le réseau DMN (default-mode network : le réseau du mode par défaut) qui définit comment notre cerveau se comporte lorsque l’on ne fait rien. Tandis que les femmes semblent plus enclines à la réflexion sur soi, la gestion des émotions ou encore récupérer des souvenirs des évènements liées à elles, on retrouve chez les hommes un engagement plus grand dans les processus d’association ou encore l’apprentissage par les récompenses. Ces différences ne sont pas dans la structure du cerveau mais bien sur comment les différentes régions interagissent.
Mythe 6 : “Cerveau gauche” VS “Cerveau droit”
Réalité : Le cerveau fonctionne comme un tout intégré, et non en deux hémisphères opposés.
L’idée que certaines personnes seraient “cerveau gauche” (logiques, analytiques) et d’autres “cerveau droit” (créatives, intuitives) est un mythe. Bien que chaque hémisphère ait des spécialisations — le langage étant généralement associé à l’hémisphère gauche et la perception spatiale au droit — les neurosciences montrent qu’ils travaillent toujours en collaboration.
Par exemple, les aires de Broca et de Wernicke, situées à gauche, sont cruciales pour la production et la compréhension du langage, mais l’hémisphère droit intervient aussi dans l’interprétation des nuances et du sens figuré. De même, la mémoire et les émotions, gérées par le système limbique, impliquent des structures situées dans les deux hémisphères.
L’origine du mythe remonte aux études des années 1960 sur les patients au cerveau “divisé”, dont le corps calleux (connexion entre les deux hémisphères) avait été sectionné. Bien que ces recherches aient révélé certaines spécialisations hémisphériques, elles ne signifient pas que l’un des hémisphères domine globalement la pensée d’une personne.
L’imagerie cérébrale moderne confirme que les fonctions cognitives reposent sur des réseaux interconnectés plutôt que sur un seul côté du cerveau. Même les tâches logiques ou créatives mobilisent les deux hémisphères, montrant que la pensée humaine est bien plus flexible et adaptative que ce que ce mythe laisse entendre.
Sources :
- Bennett, K., PhD. (2018). Despite evidence, we do not seem comfortable letting go of this neuromyth. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/modern-minds/201803/why-do-we-only-use-10-percent-the-brain
- Cadar, D. (2018). Cognitive ageing. In InTech eBooks. https://doi.org/10.5772/intechopen.79119
- Debrun, A. (2024). [Sus aux neuromythes ! ] Episode 4 : Nous n’utilisons que 10% des capacités de notre cerveau. Sydologie. https://sydologie.com/2019/10/sus-aux-neuromythes-episode-4-nous-nutilisons-que-10-des-capacites-de-notre-cerveau/
- Gur, R. C., Turetsky, B. I., Matsui, M., Yan, M., Bilker, W., Hughett, P., & Gur, R. E. (1999). Sex Differences in Brain Gray and White Matter in Healthy Young Adults: Correlations with Cognitive Performance. Journal of Neuroscience, 19(10), 4065–4072. https://doi.org/10.1523/jneurosci.19-10-04065.1999
- Harada, C. N., Love, M. C. N., & Triebel, K. L. (2013). Normal cognitive aging. Clinics in Geriatric Medicine, 29(4), 737–752. https://doi.org/10.1016/j.cger.2013.07.002
- Kolb, B., & Gibb, R. (2011). Brain plasticity and behaviour in the developing brain. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3222570/
- Plomin, R., & DeFries, J. (1980). Genetics and intelligence: Recent data. Intelligence, 4(1), 15–24. https://doi.org/10.1016/0160-2896(80)90003-3
- Plomin, R., & Deary, I. J. (2014). Genetics and intelligence differences: five special findings. Molecular Psychiatry, 20(1), 98–108. https://doi.org/10.1038/mp.2014.105
- Ryali, S., Zhang, Y., De Los Angeles, C., Supekar, K., & Menon, V. (2024). Deep learning models reveal replicable, generalizable, and behaviorally relevant sex differences in human functional brain organization. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(9). https://doi.org/10.1073/pnas.2310012121